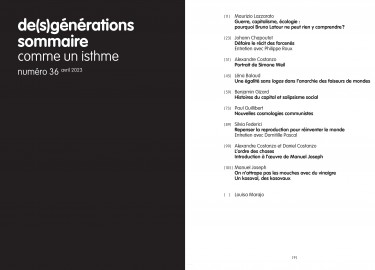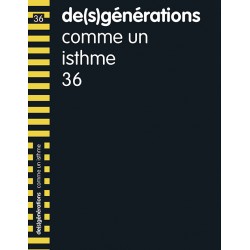






Rédacteurs : Domitille Pascal, Philippe Roux & Pascal Thevenet
Sommaire
Iconographie : Louisa Marajo
Caractéristiques techniques
Date de publication : avril 2023
Format : 14,8 x 21 cm - 112 pages
ISBN : 978-2-9570700-5-3
ISSN : 1778-0845
Édito
La revue de(s)générations, depuis sa création, n’a eu de cesse de questionner l’histoire des émancipations, en sondant leurs réussites et leurs échecs, leurs disparitions et leurs résurgences, leurs passés et leurs possibles devenirs. Dans la continuité des deux derniers numéros, « matière finie, coopérations infinies » et « attaquer l’attaque », la présente publication cherche à tracer des horizons post-capitalistes, en questionnant les expériences et les théories émancipatrices d’aujourd’hui. Cette quête est vaste et difficile – et plus que jamais nécessaire face à la catastrophe écologique et sociale en cours – car elle demande, à la fois, aux acteurs des luttes de remettre en récit le capitalisme, en dehors de celui qu'il nous assène, et d’imaginer un nouveau grand récit commun d'indépendance pour le dépasser, voire le déborder. Il ne faut pourtant pas s’y méprendre. La recherche d’une nouvelle histoire collective n’est pas qu’une affaire de théorie, elle est un combat, une pratique, qui nous demande de resémantiser nos mots et nos actions afin de construire nos luttes. Comme le disait Marx, « la théorie n’est jamais réalisée dans un peuple que dans la mesure où elle est la réalisation des besoins de ce peuple... il ne suffit pas que la pensée recherche la réalisation, il faut encore que la réalité recherche la pensée ». À l’heure des manifestations, des insurrections et des grèves qui se démultiplient partout à travers le pays, quelque chose du réel a enfin provoquer un soulèvement de la pensée, même chez ceux qui semblaient jusqu’alors les plus dépolitisés ou résignés. Il tient aujourd’hui à chacun d’entre nous de transformer les balbutiements de ces pensées en acte en énoncés libérateurs pour demain.
Le capitalisme organise depuis longtemps la fiction du self-made-man, de l’homme autonome, libre de toute forme d’interdépendances, autrement dit de l’homme sans « nous ». Ce mythe est par nature impossible. Son récit est un récit de classe basé sur les principes d’individualisation, de financiarisation, d'expropriation, sans pour autant que celui-ci ne se pose comme discours de légitimation institué. Pour mener à bien cette histoire, car il s'agit bien d'une histoire, le capitalisme réduit l’individu au statut de consommateur et de travailleur exploité, tout en opérant simultanément la liquidation pure et simple du langage lui-même. Les exemples ne manquent pas. La communication (mot qui implique pourtant étymologiquement le commun) est devenu une injure tant le néolibéralisme en a fait un de ces mots d'ordre. Il ne s’agit plus ici de penser et partager le commun par la parole mais de réduire la communication à un vocable de community manager. Nos corps sont usinés par l’esprit d’entreprise. Si le travailleur dévie ou renie ce « bel » esprit, son collaborateur le rappellera à l’ordre en lui disant que son attitude n’est pas très corporate. Les termes sont clairs, sans équivoque. L’entreprise est une corporation, une machine d’incorporation. Les travailleurs sont incorporés pour faire bloc et se fondre dans le grand corps de l’État/Capital. Être en commun n’intéresse aucunement les architectes de ce système néo-libéral. Il leur faut, pour instituer ce grand corps, établir un grand récit qui sert d’outil de communion manducatrice (de dévoration prédatrice en l’occurrence) pour mettre en marche forcée l’ensemble des peuples. C’est d’ailleurs parce que le capitalisme tend à devenir intégral, un « empire », que nous en sommes tous les prisonniers plus ou moins complices. Il faudrait aller plus loin encore dans notre raisonnement et énoncer le constat suivant : le capitalisme intégral, c’est la morgue intégrale. Marie José Mondzain écrit d’ailleurs à ce sujet dans K comme Kolonie : « Ceux qui dénoncent aujourd’hui la machine impérialiste du capitalisme comme un système dont il faut sortir semblent ignorer que ce système ne se donne aucun dehors, qu’il n’existe pas de bonne machine qui exercerait une bonne domination. Toutes les machines de domination quelles qu’elles soient transforment les hommes en machin, en machiniste, en machine, et finalement en cadavre ».
À l’heure de l’écriture de cet édito, l’éventail des répressions étatiques (usage illégitime de l’article 49.3, démultiplication des violences policières), employé face aux batailles engagées pour les retraites ou la préservation du commun fondamental qu’est l’eau, fournit un bel exemple de cette machinerie mortifère. Selon le gouvernement, c’est le corps des travailleurs qui devra faire des efforts alors que le corps de l’armée est mis sous stéroïdes. Sur fond de conflit en Ukraine, le budget pour la défense est fixé à 400 milliards d'euros sur la période 2024-2030. Un doublement pour, nous dit-on, « avoir une guerre d’avance ». De quelle guerre parle-t-on ? Ensauvagement, grand remplacement, séparatisme, islamo-gauchisme, éco-terrorisme… leurs discours ne laissent pas d’ambiguïté sur l’Ennemi désigné. L’objectif : l’ablation de tout organe défaillant qui ne réponde pas à la mécanique du Grand Corps Capitalo-Étatique. Pour ce dernier, il faut faire corps-nation, dans la métastase impérialiste du capitalisme-monde. Face à la confiscation du langage pratiquée en haut lieu, nous devons sortir de la défensive et reforger des mots et des actions plus offensifs afin de construire un rapport de force par la mobilisation. Nous perdons parce que nos représentations, notamment celle du travail, sont erronées car profondément ancrées dans le capitalisme. Ici, Paul Guillibert nous rappelle qu’« il n’y a pas un seul moment de la catastrophe écologique qui ne soit pas lié, de près ou de loin, à une certaine division du travail fondée sur la propriété privée. […] Il n’y a pas de destruction de la nature qui ne soit pas liée à des formes d’exploitation du travail ». Si le capitalisme est une morgue intégrale alors la « transition écologique » ne peut être, en réalité, autre chose qu’une transition vers le vivant. Si nous sortions de l'agriculture du travail mort (des pesticides et de la technicisation outrancière) nous pourrions reconstruire un travail vivant des terres avec tous ses acteurs humains et non-humains. L'ère du travail vivant nécessitera plus que jamais la reconstruction de la force de travail paysanne – ses savoir-faire et ses rythmes – ainsi que l'union avec les travailleurs non-humains du biotope, pour compenser l'arrêt de la machinerie mortifère du capitalisme. Le capitalisme met déjà au travail l'ensemble du vivant, à ceci près qu’il tue, autrement dit, il ne fait travailler que des morts ou des mourants. Nous devons déconstruire ce système où la production est toujours basée sur la destruction, comme l’analyse ici Maurizio Lazzarato. Pour réinventer le monde et faire passer le système capitaliste par-dessus bord, il nous faudra donc repenser la reproduction, comme nous y invite la théoricienne marxiste et militante féministe révolutionnaire Silvia Federici.
Du grand récit des forcenés aux récits des vaut-rien
Hormis le dépassement du grand récit totalisant, l’autre difficulté majeure qui nous fait face est la question du temps. En effet, écrire de nouveaux récits pour demain nécessite le temps long d’une élaboration commune par la formation, le combat et la délibération. (Re)construire la boite à outils conceptuelle doit se penser à la fois dans un temps long de formation politique, dans l'urgence des réparations écologiques et sociales et des combats qui les accompagnent. Cette arythmie temporelle, que nous n'espérons pas indépassable, est le pari révolutionnaire dont on peut considérer l’exemple du soulèvement des Gilets Jaunes comme mouvement qui, en l’espace de quelques mois, a transformé par l’action, militante, combattante, parfois violente, plusieurs générations dépolitisées, ce qui esquisse une démocratie autre. Pour reprendre Marx, il s'agissait bien d'un mouvement réel qui a essayé d'abolir l'état de choses actuel.
Construire les histoires de demain demande en amont de connaître ceux qui participent à l’en-commun. Nous constatons depuis longtemps que l'imposition du grand récit se fait toujours par et pour les vainqueurs. Les récits de l'en-commun qui travaillent la revue de(s)générations sont ceux qui, sous-jacents, sont issus de la « tradition des opprimés » telle que l’a dessinée Walter Benjamin. Pour de(s)générations, l’écriture des nouveaux récits d’émancipation ne pourra se faire sans tous « ceux qui ne sont rien ». Nous rappelons ici que ces paroles tenues en 2017 par Emmanuel Macron ne sont ni des maladresses, ni des provocations. Elles ne sont ni exceptionnelles, ni nouvelles dans le discours dominant. Elles sont, par la présente, l'illustration d'une guerre d'une classe contre une autre. Elles manifestent et expriment l'esprit du Capital. « Compter pour rien » n’est pas seulement un discours de conquérants, de « ceux qui réussissent ». Ce sont des mots programmatiques et des actes pour tous les militants de ce système qui ont besoin de ces « comptés-pour-rien » pour les servir , les habiller, les soigner, pour produire et conserver leur haut niveau de vie. Alexandre Costanzo écrit ici, dans son analyse de la pensée de Simone Weil, que le capitalisme ancre dans nos corps et nos esprits l’idée de « compter et se compter pour rien - comme condition subjective ». Cela ne s’arrête pas aux barrières de l’usine mais vaut pour tous les vivants en tous lieux. Toute l'intelligence du capitalisme est de maintenir cet état et de faire croire que celui-ci est le seul possible.
Le capitalisme n’a jamais manqué de mots et de concepts pour imposer sa loi du travail gratuit (qui par définition n’est jamais compté dans les équations du système productiviste). Pour répondre à sa logique d’accumulation des ressources et des richesses, il a inventé la race pour coloniser, piller et réduire en esclavage des peuples entiers. À la suite de la religion, en complicité avec elle, il a renforcé la différence de sexe et de genre pour « remettre les femmes à leur place », les réduisant ainsi à la domesticité, voire à la domestication. Ou encore, il a récupéré la distinction cartésienne nature/culture pour justifier l’extractivisme et l’exploitation généralisée du non-humain. La liste des producteurs/productifs non comptés dans l’équation capitaliste est gigantesque. C’est même quand on y pense la grande majorité des vivants (humains inclus) qui ne comptent pas. Ne pas compter n’est donc pas juste un effet de langage, c’est une stratégie.
Pour faire passer ce monde par-dessus bord, il faudra bien un jour réussir à conjuguer les histoires, les mémoires et les forces de tous ceux « qui ne sont rien ». Le défi est immense mais inexorable car le capitalisme est par définition le régime politique qui tient les comptes. Pour maintenir sa « balance commerciale » en faveur de la classe propriétaire exploitante, il n’hésite pas à décompter (massivement) ou à compter négativement. En effet, on n’hésite plus aujourd’hui dans la novlangue capitaliste à désigner d’« externalités négatives », les agents de dégradations de nos communs vitaux – les terres, les forêts, l’air ou l’eau. Si l’État/Capital rendait des comptes à l’ensemble de son vaste corps productif, c’est toute la classe des propriétaires-exploitants qui perdrait au change et cela ne lui est pas acceptable. Par souci de protection, ces derniers préfèrent ainsi faire des vaut-rien des vauriens… des voyous, des casseurs, des sauvages, des barbares, des extrémistes, des terroristes, des anarchistes, des communistes... La liste des termes pour désigner la dissidence semble s’allonger un peu plus chaque jour. La température augmente partout, tout comme le nombre croissant de vaut-rien dans les cortèges, les manifestations, les occupations d'usines et d'universités, les sites de production ou les ZAD.
Nous avons à écrire le récit émancipateur commun des vaut-rien face au grand récit des forcenés. Nous devons nommer nos allié.e.s. Nous devons leur rendre la parole et leur puissance de manifestation afin que chacun se constitue comme sujet politique à part entière. Nous devons construire dans les impensés de Marx, et avec toutes les autres pensées que la vieille Europe ignore. Il faut en finir avec le grand récit capitaliste pour ouvrir la voie aux cosmologies politiques démultipliées ainsi qu’aux cosmopoétiques car il n’y aura pas de reprises de terre sans reprise du sensible. Comme l’écrit Frédéric Lordon : « Présenter les choses en ces termes est peut-être une manière d’indiquer la nature du combat politique à jouer – plus exactement d’une de ses dimensions : c’est un combat d’images. La fatalité historique du communisme est de n’avoir jamais eu lieu et pourtant d’avoir été grevé d’images désastreuses. À la place desquelles il faut mettre enfin des images de ce qu’il pourrait être lui, réellement. Sortir du capitalisme demeurera un impensable tant que le communisme demeurera un infigurable (ou un « in-refigurable »)».
Il nous faut ainsi inventer des images naissantes comme les auteurs de ce numéro le suggèrent, à l’instar des nouvelles cosmologies communistes de Paul Guillibert, le « cosmo-opéraïsme » que propose Benjamin Gizard, ou encore considérer, comme Léna Balaud, l’« anarchie des faiseurs de monde » pour « construire une politique plus qu’humaine ». À ce propos, les récentes grèves, manifestations et mobilisations, sont pour nous « la preuve que ceux qui ne sont rien font en réalité partie de la communauté de ceux qui parlent », une communauté qui exprime sa puissance de manifestation au-delà des mots institués et instituants. Cette puissance de manifestation, faute d’horizon clairement tracé, sera, nous l’espérons, comme un isthme esquissant la transition du grand récit de la domination vers le lieu d’énonciation des nouvelles cosmologies à venir.
Pour conclure, nous laissons les derniers mots de cet édito à Manuel Joseph, un ami qui nous a quitté et à qui nous rendons hommage, qui écrivait que parfois « il suffit de changer l’ordre des mots pour changer les mots d’ordre ».
Domitille Pascal, Philippe Roux, Pascal Thevenet
Léna Balaud, Johann Chapoutot, Alexandre Costanzo, Daniel Costanzo, Silvia Federici, Benjamin Gizard, Paul Guillibert, Manuel Joseph, Maurizio Lazzarato, Louisa Marajo